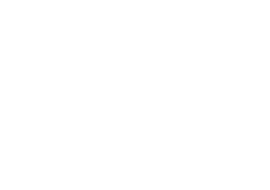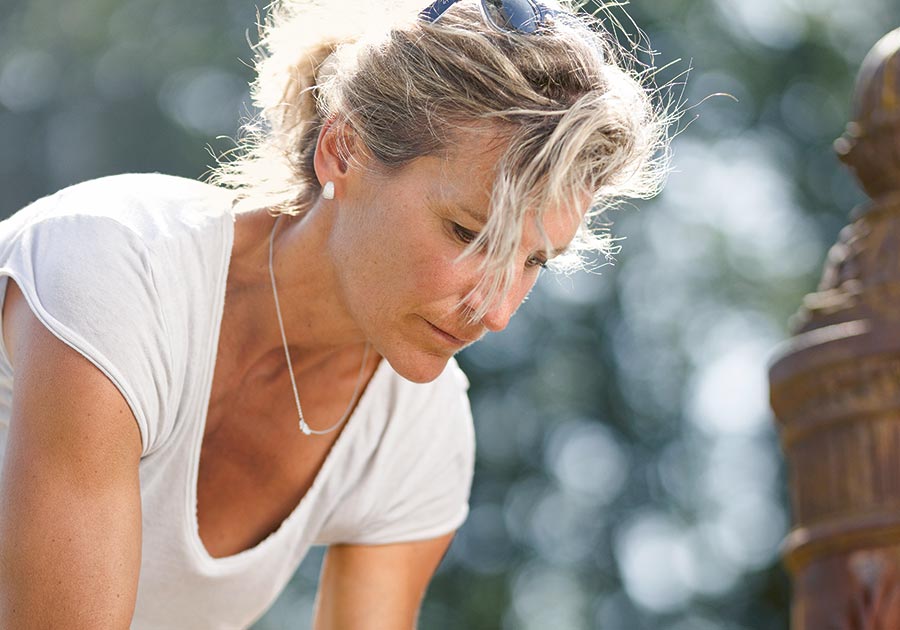Vous êtes guide de montagne et pilote d’hélicoptère. Le matériel est donc important. Avez-vous alors confiance, plus l’espoir, que le matériel tienne le coup ?
Que ce soit en montagne ou en hélicoptère, lorsque quelque chose arrive, le matériel est rarement en cause. La confiance dans le matériel s’acquiert dans le déroulement mental toujours répété des procédures d’urgence, et par le fait que l’on passe en revue lors des exercices de sauvetage et des vols de contrôle tout ce qui ne devrait pas arriver.
Donc la confiance en soi est plus importante que la confiance dans le matériel ?
Oui, car il ne faut pas paniquer en cas d’urgence. C’est l’une de mes plus grandes forces ; en situations d’urgence, je peux puiser encore 20 ou 30 pourcent dans mon réservoir d’énergie alors que la plupart des gens renoncent ou sombrent dans l’apathie. Ensuite, je me mets en pilote automatique et je fonctionne comme la situation l’exige.
Quel est l’entraînement pour cela ?
Il n’y en a pas ; je ne peux pas m’entraîner à ces attitudes ou les simuler. Ce n’est qu’avec le temps que j’ai remarqué que j’avais ce talent. Dans des situations extrêmes, je faisais simplement ce qui devait être fait, je ressentais cela comme complètement normal. Ce n’est qu’a posteriori que j’ai remarqué que ce pilote automatique d’urgence n’est pas normal, mais exceptionnel. J’actionne, pour ainsi dire, un pur instinct de survie, pour moi, mais aussi pour les personnes impliquées.
En 2001, vous êtes la première Suissesse à avoir gravi le mont Everest. Une performance exceptionnelle ! Est-ce qu’on a alors le sentiment d’avoir réussi ?
Non, ce sentiment je l’ai eu lorsqu’à 20 ans j’ai escaladé pour la première fois le pilier du Wetterhorn. Ensuite, je l’ai eu encore après avoir gravi la face nord de l’Eiger en hiver, à 22 ans. J’avais alors l’impression que personne ne pourrait m’en apprendre. À l’Everest, c’était plutôt un sentiment de récompense pour avoir beaucoup et durement travaillé, pour avoir beaucoup de connaissances et de capacités. Ce n’est qu’à mon retour en Suisse et que tout le monde célébrait ma performance, que j’ai réalisé avoir accompli quelque chose d’exceptionnel.
Aujourd’hui, les alpinistes se marchent sur les pieds à l’Everest. Est-ce que cela dévalorise votre performance de l’époque ?
Ce sont deux choses différentes. Aujourd’hui, chacun peut, de fait, « consommer » l’Everest. Ce sont pour moi des touristes de la montagne. Ils n’ont aucune idée de ce que représentent des exploits comme ceux de Reinhold Messner, le premier homme à atteindre le sommet sans bouteille d’oxygène, ou comme mon ascension en solo. Reinhold Messner a longtemps été agacé par cette évolution, personnellement, cela m’est relativement égal.
Vous n’aimez pas du tout l’expression « vaincre la montagne »…
Parce qu’elle reflète une attitude arrogante. Celui qui veut vaincre une montagne doit la déplacer. Les montagnes sont là, qu’on les gravisse ou non. Mais comme on dit ici : quoi qu’il arrive, l’Eiger s’en fiche.
Vous avez passé 484 jours en route vers le pôle Sud, à pied, en vélo et à skis. Avez-vous dû vous vaincre vous-même ?
La distance totale de plus de 25’000 kilomètres, à travers 16 pays jusqu’à l’Antarctique a été une expérience parfois extrêmement dure et pas toujours belle et intéressante. J’étais assaillie de doutes. Aurai-je assez d’argent ? Suis-je suffisamment préparée, même après une planification de quatre ans ? J’avais parfois de la peine à me motiver. Mais tous ces obstacles font que l’on se réjouit soudain de petites choses comme un lever de lune. Tous les hauts et les bas se fondent en un vécu d’une richesse extrême. Et lorsqu’au pôle Sud, on vit un phénomène météorologique qui fait que l’on pense voir quatre soleils en même temps, alors on le sait : oui, c’est justement pour cela que j’ai tout supporté. Un voyage autour du monde, en classe grand luxe, ne tient pas la comparaison.